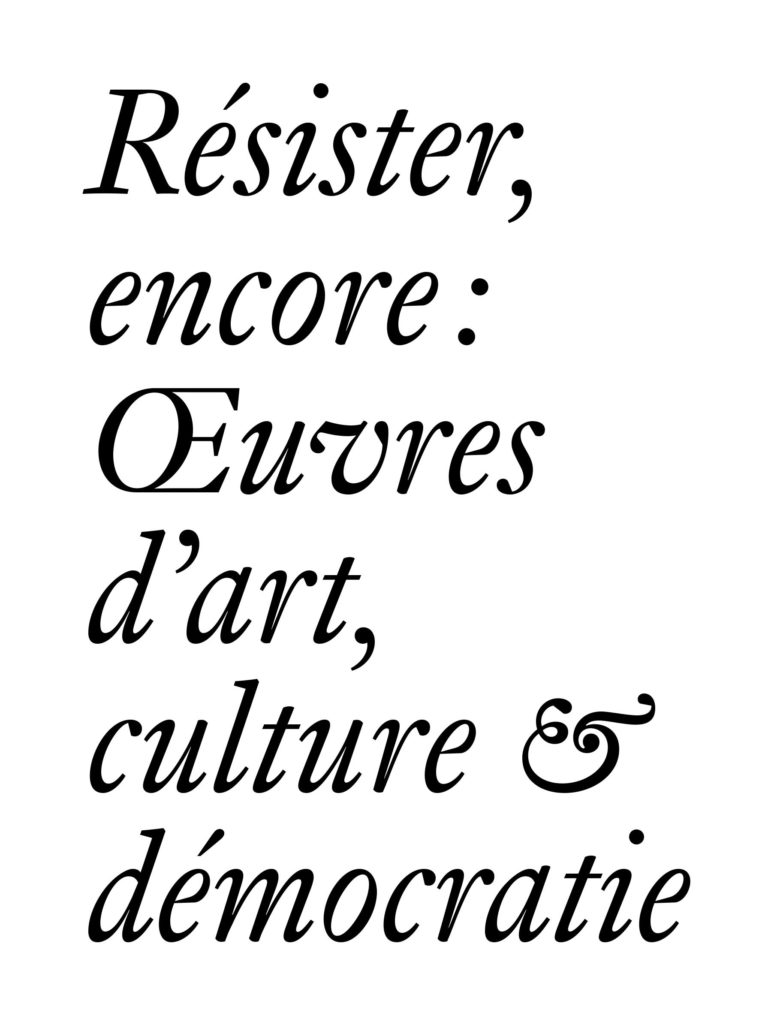Guide de visite
Résister, encore
Introduction
Retrait, silence, résilience, tollé, indignation, protestation, action, réflexion, satire… Cette exposition collective illustre les modes de résistance que les artistes ont développés face aux grands défis de notre époque: autant de stratégies de survie.
Une méfiance de plus en plus marquée envers le capitalisme néolibéral, les autorités politiques ou les privilèges systémiques incite un nombre croissant de personnes à manifester contre la violence policière, l’homophobie, la corruption, le harcèlement sexuel, la déforestation massive, la suprématie blanche, les restrictions engendrées par la pandémie, les éoliennes, le port du voile, l’immigration, la mondialisation, etc. La résistance est fondamentalement constitutive de l’art.
Résister, encore explore des stratégies de résistance exemplaires, tant individuelles que collectives, face aux grands défis de notre temps. Par le fait d’opérer dans le champ de l’«inutile», de ne pas avoir à se ranger dans un quelconque «ordre des choses», l’artiste peut se permettre de poser toutes les questions fondamentales sans se plier à un contexte politique, religieux, économique, moral, ou même esthétique. Les œuvres présentées dans le cadre de cette exposition ne sont pas des manifestes politiques d’une obédience ou d’une autre, mais des créations autonomes comme autant de modèles de mondes alternatifs.
Bernard Fibicher, directeur et commissaire de l’exposition
Les commentaires d’œuvres sont donnés par ordre alphabétique du nom des artistes.
Miriam Cahn
(Bâle, 1949)
Les toiles et les dessins de Miriam Cahn sont des arènes de lutte, des champs de bataille. Viols, exactions, rabaissements, violences physiques, torture, rien n’est épargné à celui ou celle qui ose se confronter à ses œuvres. Cette peinture spontanée, rageuse, apparemment maladroite, souvent cynique (par exemple, «schönes bild» qui signifie «belle peinture»!), est le fruit d’un exercice quotidien, d’une expression directe, des convictions de l’artiste et de sa vision d’un monde dramatique, inhumain, qui ne laisse que peu de place à la beauté, la paix et l’harmonie. Tout en affirmant les attributs sexuels de ses figures, Miriam Cahn crée un type d’être humain qui nie l’assi- gnation à un genre et à des rôles genrés. Cet être humain évolue dans un monde vide; la seule chose qui le retient dans ce néant est la couleur. Création existentielle, manifeste féministe, condamnation de toute violence destructrice – résister encore et toujours par la peinture, tel est le crédo de l’artiste bâloise.
Banu Cennetoğlu
(Ankara, 1970)
Cette œuvre rend hommage à Gurbetelli Ersöz, journaliste et unique femme ayant occupé la position de rédactrice en chef du journal pro-kurde Özgür Gündem. Après avoir été arrêtée, emprisonnée et torturée, Ersöz décide de prendre les armes et de rejoindre la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Entre 1995 et 1997, date à laquelle elle meurt au combat, elle tient un journal intime. Après sa première parution en Allemagne en 1998, le journal est publié dans sa langue originale, le turc, en 2014, mais il est interdit de distribution en Turquie. Les pierres lithographiques présentées dans l’étagère en acier de Gurbet’s Diary (2016-2017) de Banu Cennetoğlu contiennent la totalité des passages du journal dans leur tra- duction grecque, travail réalisé à l’occasion de la présentation de cette œuvre à la documenta 14 (2017) à Athènes, dans le parc de la bibliothèque Gennadius. Le texte du journal est prêt à être imprimé et forme en même temps une sculpture lourde, un mur, un acte de mémoire.
Michel François
(Saint-Trond, 1956)
Michel François a souvent travaillé sur des dispositifs de passage d’un ici contraignant à un au-delà plus libre: il a dessiné un plan de cellule éphémère, élaboré des plans d’évasion, construit un pavillon brisé, pratiqué des trous dans un mur… Cette cage dorée à la feuille (Golden Cage II, 2009) est une construction instable et fragile, à la fois une barrière et une ouverture, symbole paradoxal de confinement et de passage outre. Le scintillement doré de la cage rapproche celle-ci de la pile d’affiches trouées figurant un trésor: des monnaies du monde entier, parmi lesquelles on découvre cependant aussi des douilles d’armes à feu. Ces travaux évoquent la problématique (sociale ? politique ?) des antagonismes suivants : inclusion vs exclusion, liberté vs pouvoir. En guise de réponse, l’artiste belge propose des espaces de liberté où tout est mouvement (le dessin mural Instant Drawing (2022) avec les blocs de chêne «mobiles») et processus, en même temps ceci et cela.
Philip Guston
(Montréal, 1913 – Woodstock, 1980)
L’artiste américain d’origine juive Philip Guston avait fait scandale à l’époque – et aujourd’hui davantage encore – en représentant des membres du Ku Klux Klan à la coiffe pointue dans des actions quotidiennes telles que fumer un cigare, converser, dormir, conduire une voiture, ou… peindre. En s’identifiant avec le mal, en explorant la complexité psychologique et morale du vice, Guston nous renvoie aux dilemmes existentiels engendrés par la suprématie blanche. La toile blanche du peintre est la même toile dont est faite la coiffe pointue des membres du Klan. Pire: les figures de Guston semblent tirées d’une bande dessinée. La suprématie blanche s’est donc confortablement installée dans la culture populaire – autre forme de banalisation de la violence, qui ne peut apparaître que comme scandaleuse.
Thomas Hirschhorn
(Berne, 1957)
Pour un artiste qui affirme que «[s]on problème en tant qu’artiste – et le problème de l’art – est de donner forme », la ruine offre un terrain d’exercice parfait, puisqu’«une ruine est une forme, une forme éternelle, universelle et intemporelle». Une forme qui résulte de la destruction d’une forme. Donc une chose à considérer pour elle-même. Le titre de ce collage, A Ruin is a Ruin (2016), fait d’ailleurs écho à la célèbre tautologie de l’autrice et collectionneuse américaine Gertrude Stein «A rose is a rose is a rose», figurant dans son poème Sacred Emily de 1913. «Une ruine, poursuit Thomas Hirschhorn , est un lieu abstrait, intemporel, libre de toute valeur.» Le collage permet l’assemblage sur un même plan de ruines de différentes époques et, de ce fait, une analyse comparative de ses différentes formes. Cette lecture formaliste révèle cependant un état du monde éternellement tragique fait de «ruines archéologiques, corruption, désastres naturels, feu, eau, erreurs de construction, collapse culturel, politique, esthétique ou économique, faiblesses matérielles, négligence, accident, bombardement».
Amar Kanwar
(New Delhi, 1964)
Ce poème visuel du cinéaste indien Amar Kanwar , intitulé Such a Morning (2017), est subversif par le fait de traiter de la perception des nuances dans un monde qui fonctionne de plus en plus avec des slogans, des messages abrégés et des systèmes binaires. Il présente deux personnes, un homme et une femme, dans leur projet volontairement solitaire. Un mathématicien, qui a quitté du jour au lendemain l’université dans laquelle il travaille, se retire en pleine forêt, dans un wagon de train abandonné, pour étudier l’obscurité dans toute sa subtilité. Sa conscience gagne en clarté au fur et à mesure que le monde s’obscurcit. Son habitacle est le symbole pessimiste d’un impossible voyage et d’un impossible progrès. Seule une recherche contemplative hors du monde est encore possible. L’autre personnage est une femme tranquillement assise dans un fauteuil en train de lire pendant que sa maison est démolie tout autour d’elle. Ici, on assiste à une irruption progressive de lumière. Ce sont deux formes de résistance individuelle non passives, mais symboliques, qui de- viennent exemplaires par le fait de les rendre publiques à travers le cinéma.
William Kentridge
(Johannesburg, 1955)
L’installation vidéo Notes Towards a Model Opera (2014-2015) de l’artiste sud-africain est le résultat de longues recherches au sujet du phénomène de l’«opéra modèle», genre inventé durant la Révolution culturelle en Chine (1966-1976). Ces opéras avaient pour but de célébrer la lutte des classes et ses héros prolétaires (ouvriers et paysans), de construire une nouvelle mémoire sociale opposée à l’idéologie «féodale» de la Chine ancienne, et de glorifier la Chine révolutionnaire grâce à ses victoires contre ses ennemis tels que le Japon. William Kentridge tente de rapprocher cette transformation esthétique et idéologique de l’opéra-ballet révolutionnaire chinois avec le contexte sud-africain, son histoire de dirigeants socialistes et sa tradition musicale de groupes de danse «coloniale» des années 1950. Il a étroitement collaboré avec la célèbre chorégraphe et danseuse Dada Masilo (Soweto, 1985) pour développer un langage expres- sivement ironique. Les nombreuses citations et injonctions sur posters (comme « Seize the ego »[Emparez-vous de l’égo], «Be not so refined [Ne soyez pas si raffinés], « Crush the 4 olds » [Écrasez les quatre vieilleries]) déconstruisent l’art en tant que véhicule de propagande politique et font de Notes Towards a Model Opera une œuvre autonome et de portée universelle.
Kimsooja
(Daegu, 1957)
D’origine sud-coréenne, Kimsooja utilise depuis le début des années 1990 des bottari, baluchons faits à partir de couvre-lits colorés traditionnellement utilisés en Corée pour déménager des vêtements et des objets quotidiens. Tantôt elle les disperse à même le sol, seuls ou en groupe, tantôt elle les intègre à des vidéos et des performances, ficelés sur la plate-forme d’un pick-up, traversant villes et campagnes, ou dans des objets-sculptures comme ce Bottari Tricycle ( 2008 ). Cette pièce peut être montrée de deux manières : dans une version « classique » avec le vélo sur ses trois-roues et les bottari solidement amassés à l’arrière, ou dans une version « baroque » avec le vélo câbré et les baluchons déversés sur le sol. Elle est ici présentée dans cette seconde version, plus dramatique, qui renvoie aux dangers liés à la migration et aux tragédies causées par le déplacement forcé. Table de conférence ? Paysage cosmique ?
Jardinage selon la méthode Fukuoka ? Il n’y a pas de règles du jeu dans Archive of Mind ( 2017 ). Nous comprenons cependant instinctivement que nous sommes invité·e·s à prendre part à une expérience collective, à nous saisir d’une poignée d’argile, de la façonner en boule puis de la déposer sur le vaste plateau de la table. Il s’agit d’une composition littérale, du latin com ( avec, ensemble ) et ponere ( poser ). Cette œuvre collective se nourrit de l’énergie et de la patience de chaque individu. Chaque boule est différente et conserve les empreintes singulières de nos mains. Cette archive de nos corps, fruit d’une activité manuelle, se transcende en un acte de méditation collective : archive de l’esprit. La constellation de boules d’argile, qui se transforme en cours d’exposition, nous apprend par l’expérience que nous sommes simultanément des individus et des êtres sociaux, isolés et connectés, corps et conscience supérieure.
Sigalit Landau
(Jérusalem, 1969)
Sigalit Landau a réalisé la performance Barbed Hula (2001) sans public, devant le seul œil de la caméra, au lever du soleil sur une plage au sud de Tel Aviv (constituant l’unique frontière calme et naturelle d’Israël). Elle se filme nue, sans montrer son visage, en train de danser le hula hoop en faisant tourner autour de sa taille un cerceau de fil barbelé qui symbolise la frontière et la réclusion. L’utilisation du ralenti et le long plan séquence en zoom progressif augmentent le degré de sensation de douleur auprès des spectatrices et des spectateurs, bien que la plupart des pointes de fer soient tournées vers l’extérieur. L’artiste a bénéficié d’une première formation de danseuse, puis à dû s’astreindre au service obligatoire dans l’armée israélienne. Son œuvre est intimement liée au corps et aux notions de résistance et d’épuisement.
À propos de Salted Lake (Salt Crystal Shoes on a Frozen Lake) (2011), Sigalit Landau explique: «J’ai fabriqué des chaussures recouvertes de gros cristaux de sel en les suspendant dans les eaux salines de la mer Morte. Ensuite, je les ai emportées près d’un lac gelé au milieu de l’Europe et placées sur la glace. Chaque chaussure a fait fondre la glace et creusé un trou. La nuit, elles ont finalement sombré en se noyant dans le lac d’eau douce, chargées de la pesanteur de l’histoire. J’ai tourné la vidéo en Pologne, dans la ville révolutionnaire de Gdansk, pour créer une œuvre qui touche à la mémoire et à la douleur collectives.» Le titre de la vidéo, signifiant «lac salé (chaussures en cristaux de sel sur un lac gelé)», suggère déjà un paradoxe. Faut-il voir dans ce travail une allusion au naufrage des tentatives de migration, selon le flux traditionnel du sud vers le nord? La bande-son (des bruits du chantier naval de Gdansk) ajoute en tout cas une note dramatique à ces images relativement statiques.
Nalini Malani
(Karachi, 1946)
Le titre de l’œuvre Can You Hear Me ? (2018-2020) provient d’une animation réalisée en 2018 à propos d’une fille mineure qui a été violée, puis assassinée, mais que personne n’a entendu crier. Cette voix des dépossédé.e.s qui n’est pas entendue ou qui est délibérément ignorée est exprimée dans différents registres, allant de l’ironie à l’absurde, et est accompagnée de couleurs vives et de sons rapides. Nalini Malani appelle cette installation complexe une «chambre d’animation qui contient les voix dans ma tête et mon cœur, en simulant la manière dont mon esprit fonctionne, en tant que chaos ordonné». Le point de départ de ces dessins réalisés au doigt sur un iPad est souvent une citation (notamment de Bertolt Brecht, George Orwell, Hannah Arendt, Milan Kundera et Mohammed El Faïz). Les séquences d’images, les textes et les sons se bousculent et nous font peu à peu prendre conscience qu’il y est question de violence, d’injustice, de fondamentalisme, de discrimination et de destruction de l’environnement.
Teresa Margolles
(Culiacán, 1963)
Tout l’œuvre de l’artiste mexicaine Teresa Margolles tourne autour du thème de la mort. Les tissus étalés sur des tables lumineuses, un peu comme sur des tables de dissection, sont imprégnés du sang et des fluides corporels de femmes assassinées dans différents pays d’Amérique latine (Guatemala, Mexique, Nicaragua). Des associations de femmes engagées ont été invitées à broder des motifs typiques de leur culture (Maya, par exemple, dans Nkijak b’ey Pa jun utz laj K’aslemal (Opening Paths to Social Justice), 2012-2015) sur ces tissus, en un acte de commémoration et de révolte. Selon l’artiste, le projet s’articule autour du concept de la résistance. Ces œuvres ne sont donc pas seulement de terrifiants témoignages de féminicides (encore plus éprouvants physiquement sous le «parasol» de l’œuvre Frazada (La Sombra), Blanket (The Shade) (2016) présentée au deuxième étage du Musée), mais aussi des exemples concrets de lutte contre la violence, d’une sorte d’activisme silencieux, de réparation par et à travers la culture.
Zanele Muholi
(Umlazi, 1972)
Ces six tirages gigantesques ont été sélectionnés par Zanele Muholi dans sa série Somnyama Ngonyama [Salut à toi, lionne noire], débutée en 2014, qui comprend aujourd’hui plus de 100 photographies consistant en des autoportraits. L’artiste et «activiste visuel.le» LGBTQI+ sud-africain.e se métamorphose en différentes représentations de femmes noires au moyen de parures et autres coiffes de fortune, faisant à chaque fois, selon ses mots, «référence à un cas particulier, à un personnage historique ou à une expérience – personnelle, sociopolitique, culturelle». Muholi ne représente pas ces femmes mais les incarne. Les objets souvent ridicules dont l’artiste s’affuble et la mise en avant de clichés ne parviennent pas à effacer la portée sérieuse du son message, souligné par son regard perçant: la condamnation de la discrimination raciale et sexuelle. La série photographique de l’artiste est «comme une gigantesque pride à elle toute seule».
Félix Vallotton
(Lausanne, 1865 – Paris, 1925)
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Félix Vallotton se porte volontaire pour combattre, mais il est refusé en raison de son âge. Ce n’est qu’en 1917 qu’il pourra se rendre sur le front «en mission artistique aux armées». Les six gravures sur bois qui forment le recueil «C’est la Guerre!» (1915-1916) et mettent en scène le sort tragique des soldats dans les tranchées et les souffrances des civils, ne reposent donc pas sur des expériences vécues. Ce sont plutôt des tentatives (virtuoses!) de mise en forme de scènes de destruction à travers l’imagination d’une personne à la fois horrifiée et fascinée par la guerre moderne, déshumanisée, sans visage. Soldats morts pris dans des entrelacs de fil barbelé, explosions d’obus, scènes d’orgie et de viol deviennent des motifs de compositions presque abstraites en noir et blanc évoquant un monde de ténèbres: des images de chaos superbement ordonnées.